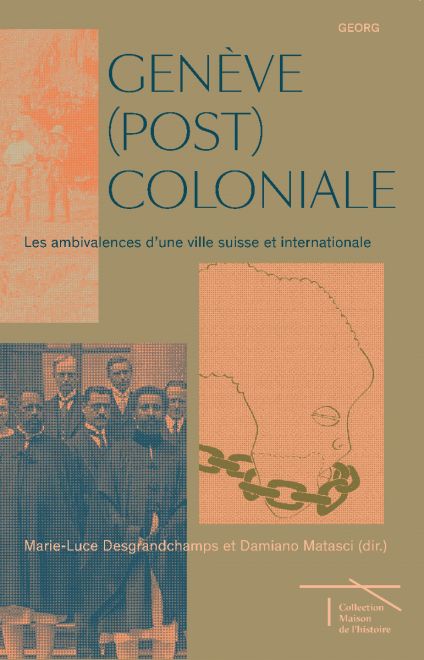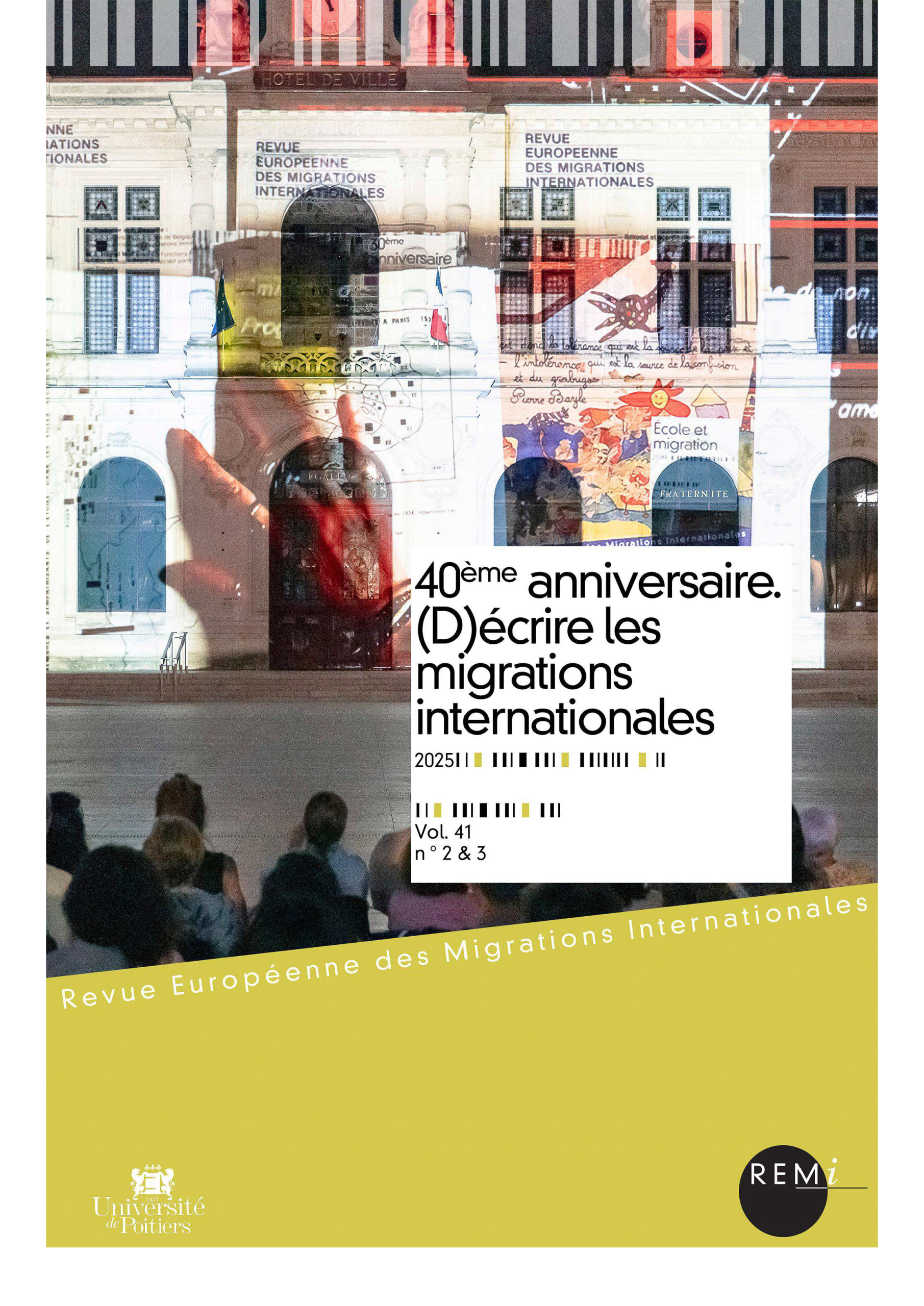La médiation ludique : un nouvel écart entre le musée et ses publics ?
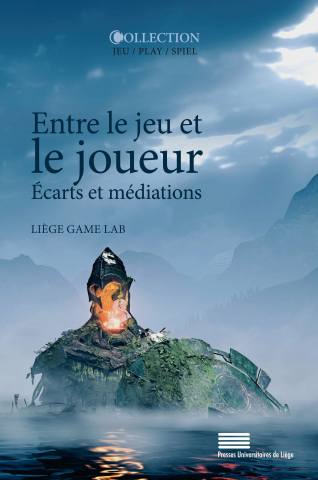
De Nicolas Doduik, chapitre d’ouvrage ENTRE LE JEU ET LE JOUEUR, Presses universitaires de Liège, 2023, p. 287-308
Dans le champ des musées, professionnels et observateurs considèrent généralement qu’un contenu culturel n’est jamais accessible immédiatement. C’est précisément le rôle de la « médiation culturelle » d’ajouter un élément médian entre un contenu culturel et ses récepteurs pour accompagner sa réception. Pourtant, un certain discours sur l’immédiateté de l’expérience ludique trouve des échos dans le monde muséal : les jeux y sont parfois promus comme une manière de s’approprier immédiatement des contenus culturels. Cet article s’intéresse à deux jeux créés au Mucem (Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée), musée public national situé à Marseille. À partir d’une observation participante et d’entretiens avec des professionnels de ce musée, il cherche à s’interroger sur la pertinence du choix d’objets ludiques comme objets de médiation. Il montre que, paradoxalement, les jeux censés faciliter l’appropriation de contenus muséaux par des publics non pratiquants du musée peuvent la complexifier, en nécessitant de nouvelles médiations dues aux codes ludiques et muséaux qu’il faut maitriser pour utiliser ces objets. Cette conclusion nuance le caractère supposé immédiat de l’expérience ludique, et la capacité des jeux de musée à combler l’écart entre le musée et ses publics..
Disponible en open access
Voir la référence complète de la notice sur HAL
Partager sur
Lire aussi