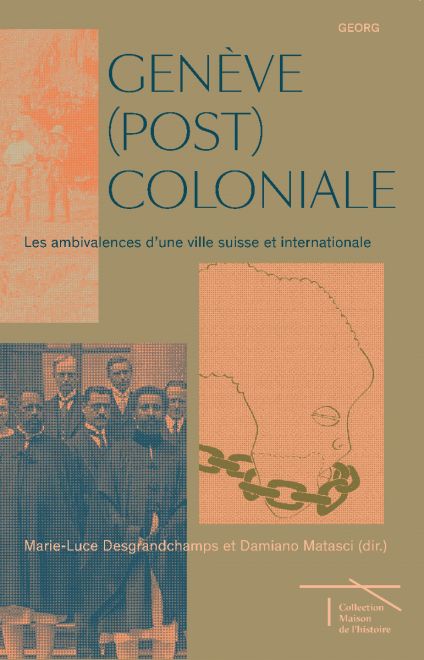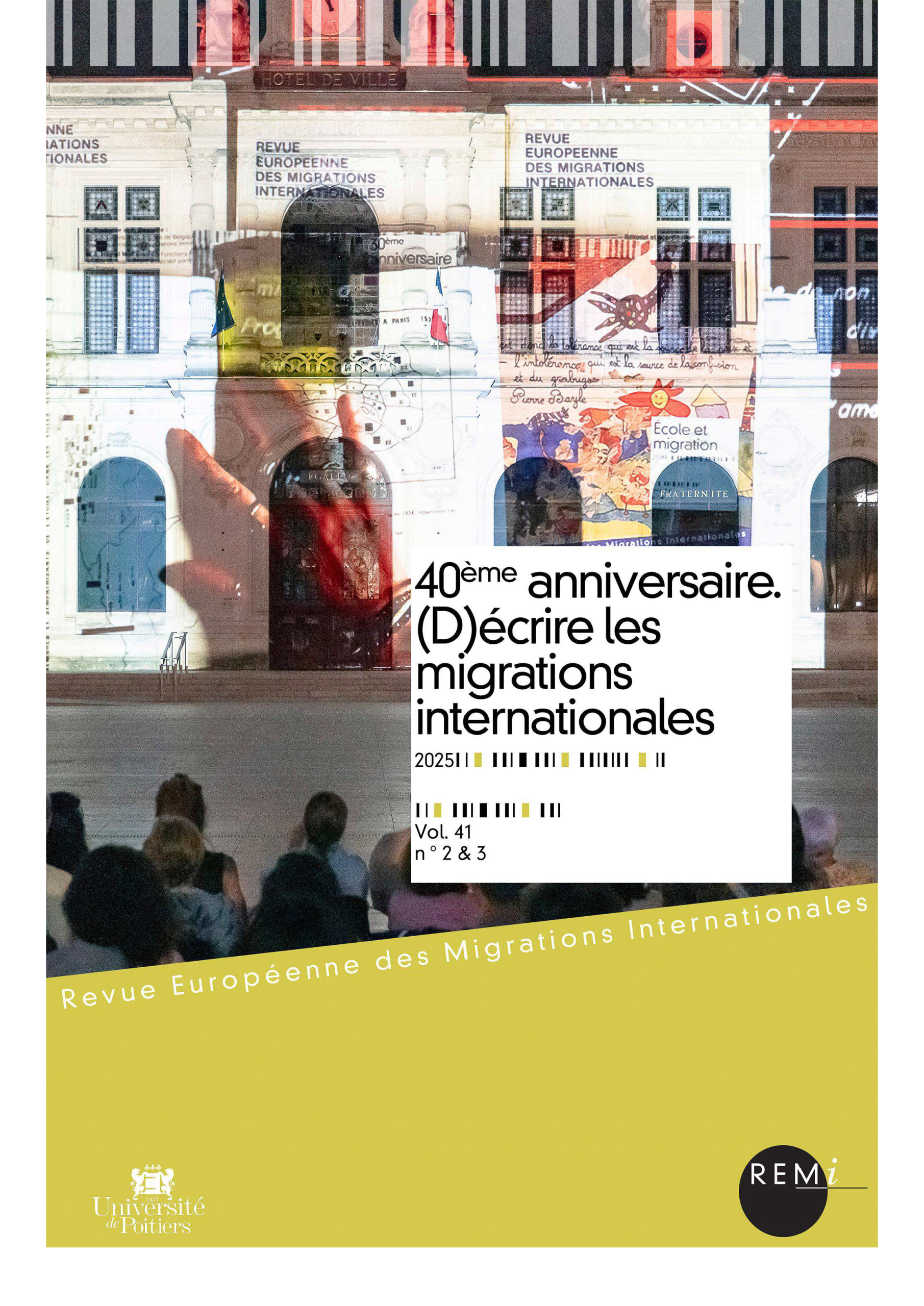Lauréat du Prix de thèse « Valois » 2025 : félicitations à Anton Olive-Alvarez !

Le prix de thèse « Valois », Jeunes chercheuses et chercheurs est une aide à la publication. Cette aide récompense chaque année 3 thèses de doctorat pour leur qualité, leur originalité et leur apport essentiel aux politiques culturelles du ministère de la Culture.
Anton Olive-Alvarez figure parmi les lauréats de l’édition 2025 pour sa thèse « Entre le terrain et le musée : légitimation partielle du street-art et appropriation intermédiaire de l’espace », dirigée par Sylvie Mazzella (CNRS, MESOPOLHIS) et Gisèle Sapiro (CNRS/EHESS, CESSP) et soutenue le 18 novembre 2024 à Aix-en-Provence.
Une remise de prix est prévue le jeudi 27 novembre 2025 dans les salons du ministère de la Culture.
Toutes nos félicitations au lauréat !
Résumé de la thèse :
Ce travail interroge l’accroissement spectaculaire des projets légaux de street-art dans les villes françaises et européennes dans la dernière décennie. Après une phase de retournement progressif du stigmate social et artistique associé au graffiti à partir des années 2000, on assiste en effet à une explosion de festivals et de parcours de street-art promus par les municipalités depuis la deuxième partie des années 2010. L’enquête porte sur le suivi de différents projets de ce type, réalisés dans les villes de Paris, Marseille et Bruxelles. Elle repose sur un large volet qualitatif (entretiens, immersion auprès d’acteur·ices en charge des projets, observations directes dans les lieux concernés), complété par des traitements quantitatifs (ACM, statistiques descriptives). L’objectif général est ainsi d’entrer en détail dans l’homologie entre dimensions sociales, symboliques et morphologiques de l’espace urbain, pour documenter empiriquement les processus menant à des tentatives d’appropriation symbolique de certains quartiers par l’art, et pour les confronter à leurs effets réels.
En revenant sur l’histoire de l’autonomisation d’une pratique spécifique du street-art, et en rendant compte de l’état actuel du champ du street-art français, la thèse s’attache dans un premier temps à identifier une nouvelle phase de la légitimation de cet art, caractérisée par sa prise en charge par les pouvoirs publics locaux dans le cadre de politiques de développement urbain. On montre comment se construisent des coalitions d’acteur·rices qualifiées de « développementalistes » au sens de Clarence Stone, qui se fédèrent autour d’une conception instrumentale du street-art et de ses effets dans la ville. Sans constituer l’unique manière de créer des projets de street-art, cette forme développementaliste acquiert une position hégémonique dans l’espace de la production des fresques murales, et tend à déterminer une modalité dominante de production de street-art dans l’espace urbain, marquée par une forte hétéronomie.
La deuxième partie du travail s’attache alors à identifier les effets esthétiques de cette hégémonie développementaliste, dans le type de fresques produites. En proposant une méthodologie d’analyse du contenu iconographique des œuvres, on met en lumière la manière dont s’impose une uniformité esthétique, caractérisée par la recherche constante de consensus formel, que l’on peut considérer comme la transcription esthétique de l’impératif de consensus qui préside à l’élaboration de ces projets. Cette iconographie développementaliste s’impose progressivement et s’élargit à un nombre croissant de paysages urbains différents, au point qu’elle semble être investie par les acteur·rices concerné·es d’une propension intrinsèque à opérer une transformation urbaine.
La dernière partie de la thèse tente alors de poser empiriquement la question de ce pouvoir transformateur des fresques de street-art. L’imposition dans l’espace de formes esthétiques investies d’un pouvoir symbolique de développement urbain conduit-elle nécessairement à un renouvellement effectif de la population des lieux concernés, et dès lors à des logiques de gentrification ? En s’appuyant notamment sur des méthodes issues de la sociologie de la réception, on propose ici d’objectiver le caractère plus ou moins marquant du street-art dans la ville en partant des usages concrets de l’espace urbain engagés par les (multiples) pratiques de visites liées au street-art. Puis on mobilise un cas particulier d’institutionnalisation d’un projet de street-art vandale dans la périphérie parisienne pour interroger l’évolution des usages urbains associés à ce processus. On conclut plutôt qu’à un inévitable phénomène de gentrification, à la structuration et au développement d’appropriations intermédiaires de l’espace urbain.
Partager sur
Lire aussi